Cela fait des années que nous suivons Sébastien Rutés et nous sommes toujours (agréablement) surpris par ses changements de style et d’ambiance. Pas de littérature ! sorti chez Gallimard, est un hommage aux romans noirs américains des années 1950 publiés à la Série Noire. Il y est, bien évidemment, fortement question de traduction… D’où ces quelques questions à l’auteur et traducteur.
Nous nous étions quittés sur le très noir Mictlán, quels en ont été les retours ?
Je crois qu’aucun de mes romans n’avait fait autant réagir. Mictlán, par sa noirceur, a eu l’air de toucher à quelque chose de profondément ancré chez le lecteur, au-delà du contexte particulier de la violence liée au narcotrafic au Mexique : les morts que l’on porte avec nous tout au long de notre vie, la solitude de l’existence, la sensation d’emprisonnement dans un destin sans échappatoire… D’autant que la structure circulaire du texte, avec ses phrases de plusieurs pages, retient le lecteur prisonnier, il y a une sensation claustrophobe à la lecture. Le roman a reçu le prix Mystère de la critique et le prix Marianne – Un aller-retour dans le noir, signe de son excellent accueil.

Pas de littérature !, beaucoup plus léger, est un hommage et un questionnement. D’où vous est venue cette idée de roman ?
Après Mictlán, j’avais commencé un autre roman très noir, plus social celui-là, mais en plein confinement j’ai ressenti le besoin d’un peu de légèreté. Pas de littérature ! m’offre l’occasion d’un retour à un sujet réconfortant pour moi, un refuge : la littérature, et comment elle aide à appréhender l’incessante évolution du monde et à lui donner du sens. La Série Noire ne vient qu’en second, parce que le concept de traduction sous-tend cette idée de la littérature comme mouvement. Sans compter que le roman parle de moi, qui suis à la fois auteur et traducteur, de mon rapport aux mots, de ma quête de style et de mes errements.
Pas de littérature ! se déroule en 1950 et on y voit Gringoire Centon, auteur et traducteur pour la Série Noire, bataillant avec ses traductions. Nous avons demandé à Sébastien Rutés de commenter quelques phrases extraites de son roman.
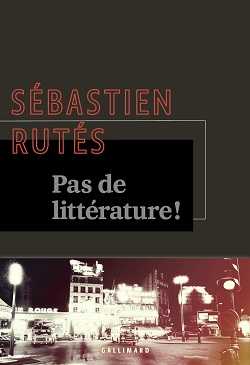
De la traduction
« Vous en faites un beau, d’agent double ! Et même triple. Un traducteur, ça fait cocu deux langues. Vous, vous réussissez à trahir l’anglais, le français et l’argot. Vous êtes le Mata-Hari des langues vivantes ! »
Grâce à de vagues amitiés littéraires d’avant-guerre, Gringoire a été recruté comme traducteur à la Série Noire sur la base d’un court séjour à Londres pendant l’Occupation, séjour qui lui vaut une réputation de résistant et d’anglophone distingué, usurpée dans les deux cas. En réalité, il n’est pas doué pour les langues et n’a d’autre recours que de faire traduire son épouse à sa place, en cachette. Lui se contente de transcrire la traduction en argot. Mais, une fois encore, la langue verte ne lui est pas naturelle, il doit arpenter les bars mal famés de la capitale, un carnet et un crayon en poche, pour s’inspirer. Ici, ce qui dit le Sachem, ce vieux truand qui fait de Gringoire son biographe, n’est qu’une version du traduttore tradittore adaptée au contexte de guerre froide. J’ai joué beaucoup sur le rapprochement du monde de la pègre et de celui de la littérature, notamment par l’intermédiaire de leurs langages respectifs : souvent, l’un métaphorise l’autre. En réalité, dans le cas présent, le vrai traducteur est le Sachem, qui transpose une réalité dans une autre grâce à la métaphore.
« C’est comme la traduction, intervins-je. La langue évolue, le monde aussi. Traduire, c’est rendre compte du temps qui passe ».
C’est une vaste question qui comporte de nombreux aspects. Le problème du rapport de la littérature au temps est complexe. Déjà, la langue. C’est Steiner, dans Après Babel, qui dit qu’une langue est le modèle le plus juste du principe d’Héraclite. La langue est en perpétuelle mutation mais, lorsqu’on lit, on ne tient pas compte de cette évolution. Les mots sur le papier ont pour nous le sens qu’on leur donne au moment de la lecture. « On lit comme si le temps s’était arrêté », dit Steiner. Le traducteur, lui, doit tenir compte de ces évolutions : traduire ce n’est pas seulement transposer un mot d’une langue dans une autre mais tenir compte de sa valeur aux deux moments de l’écriture et de la lecture. Il y a une dimension synchronique de la traduction –deux langues, deux contextes culturels, deux destinataires– mais il y a aussi une dimension diachronique, surtout si l’on traduit des textes plus anciens. Voilà pourquoi les traductions peuvent être actualisées. Dans une langue, à plus forte raison dans un texte, à plus forte raison dans une traduction, tout est mouvement, adaptation, dialectique, et dans Pas de littérature ! j’en fait la métaphore de la constante métamorphose du monde.
Pas de littérature ! m’offre l’occasion d’un retour à un sujet réconfortant pour moi, un refuge : la littérature, et comment elle aide à appréhender l’incessante évolution du monde et à lui donner du sens.
« C’est une question de disposition d’esprit. Un traducteur digne de ce nom sait que la vérité est dans la translation. Pas d’un côté ou de l’autre mais dans le va-et-vient entre les deux ».
Je situe le roman au début de la guerre froide, au moment de la bipolarisation, en écho à la question des deux langues d’une traduction. La guerre a ouvert le monde, elle l’a mis en mouvement et montré la fragilité des identités qu’on pensait naturelles. La France que je dépeins se débat entre américanisation et influence communiste, la plupart des gens ne pensent qu’à rétablir les repères d’avant-guerre, alors que d’autres, comme Gringoire, à son insu, se font les apôtres d’une troisième voie, la réinvention des identités locales, leur revitalisation à partir de l’universel. Ici encore, la traduction fait office de métaphore d’une attitude au monde : il n’y a pas d’absolu, rien à quoi revenir, les essentialismes n’ont pas de sens, c’est au contraire l’adaptation et la transformation qui donnent sa valeur à une culture, le flux dans lequel elle s’inscrit, le processus. Pour en revenir à la Série Noire, ce ne sont pas, à mon avis, tant les textes originaux ni les traductions qui lui donnent sa valeur, mais comment cette collection crée, de façon plus ou moins intentionnelle, une réalité nouvelle, une littérature nouvelle, son propre objet.
Duhamel et sa philosophie
« Nous adaptons l’Amérique au goût du public français ».
D’abord, soyons honnête, je ne suis pas chercheur, je ne sais pas exactement quelle était la philosophie de Marcel Duhamel. Lui-même, dans ses mémoires, parle à peine de la Série Noire. J’ai lu ou écouté des interviews, lu un peu de la production académique, mais surtout, je vois le résultat : ce que la Série Noire a été, ce qu’elle a représenté. En premier lieu, il y a dans l’immédiat après-guerre une curiosité pour tout ce qui est américain, c’est pourquoi le choix de ce qu’on donne à voir ou à lire est crucial. Il est évident que la sélection des textes opérée par Duhamel a une influence sur l’image que les Français se font de l’Amérique, en particulier au moment où les tirages deviennent massifs (n’oublions pas que les premiers textes que la Série Noire donne à lire sont le fait d’auteurs anglais qui n’ont jamais vécu outre-Atlantique et qui écrivent avec un dictionnaire d’argot américain). Ensuite, il y a évidemment la question des traductions : qu’est-ce qu’on traduit, qu’est-ce qu’on ne traduit pas, qu’est-ce qu’on laisse de côté ? Ces questions, tout traducteur se les pose, on ne peut jamais tout transposer, il faut se résoudre à des déperditions de sens. Mais en ce qui concerne la Série Noire, c’est l’élagage à la sulfateuse, on perd des paragraphes entiers, des chapitres, qui ne correspondent pas à l’idée que Duhamel se fait des attentes de son lectorat (pas de littérature, pas de psychologie, de l’action, rien que de l’action). Voilà d’ailleurs ce qui est intéressant : la Série Noire prétend donner au public français ce qu’il attend, ce qui correspond à l’image qu’il se fait de l’Amérique, mais en même temps elle contribue grandement à construire cette image et à informer la vision de son lectorat. Il y a un mouvement de va-et-vient qui nous ramène à la question précédente. L’adaptation des textes créé une réalité nouvelle, intermédiaire, nourrie de représentations américaines et françaises à la fois, un objet littéraire unique.
« Je fais ce qu’on me demande. Duhamel se voit comme un passeur culturel, il attend des traducteurs qu’ils facilitent la compréhension du lecteur ».
J’ignore si c’était vraiment ce que pensait Duhamel. Ce que je sais, c’est que la Série Noire des origines met le curseur plutôt sur le lecteur que sur le texte, je veux dire que le texte en lui-même a moins d’importance que sa réception. Mais il est évident que les romanciers américains donnent de leur réalité une image déformée dont la traduction accentue la déformation. Il y a un effet spéculaire qui brouille l’image de l’Amérique plus qu’elle ne l’explique. Bonne chance au lecteur de 1950 qui voyagerait aux Etats-Unis avec un volume de la Série Noire pour guide. Or, à la même époque, comme on le voit dans le roman, le Département d’Etat américain lance une grande offensive culturelle pour faire la promotion de l’american way of life en Europe. Il y a un bureau qui est spécialement créé pour la guerre psychologique, c’est-à-dire la propagande. Des expositions itinérantes parcourent la France avec des posters, des affiches, des films publicitaires. Rien de tout cela ne représente la réalité, pas plus que les traductions de textes américains que la Série Noire donne à lire, ce sont des versions de la réalité : on est entré dans l’ère des versions, ces ancêtres des « réalités alternatives » chères à Trump, c’est pourquoi le traducteur va se retrouver au centre du jeu, habitué qu’il est à se mouvoir entre les variantes et à interpréter les énoncés. Car, désormais, tout sera question d’interprétation.
« Duhamel voulait le langage parlé de la rue mais il en ignorait à peu près tout, à l’instar de la majorité de nos lecteurs. Quelqu’un aurait-il fait la différence si j’avais inventé mon argot moi-même ? »
Comme je l’ai dit, il me semble que la Série Noire crée quelque chose, volontairement ou pas : une image de l’Amérique mais aussi un style, une forme, presque un genre. Les auteurs français qui vont publier dans la collection s’inspireront moins des romans américains (sans parle de la réalité américaine elle-même) que de la version tronquée qu’en donnent les traductions. Ils reprendront des codes qui sont en partie la conséquence de choix de traduction. Il me semble qu’il en va de même de l’argot, qui se voit adapté à la compréhension du lecteur et à ses attentes. Pour moi, la Série Noire des débuts, c’est avant tout un objet artistique qu’il faut juger à l’aune de sa capacité de création. Comme je le dis dans le roman, une littérature sans auteur, au sens où la traduction telle qu’elle a pu être pratiquée annule dans une certaine mesure –pas entièrement– les particularités du style de chacun. Le lecteur n’achète pas un Hadley Chase ou un Peter Cheney, il achète une Série Noire, ce qui lui garantit un certain nombre de choses : un type de personnages, une vision du monde, un langage (et même un nombre de pages). Mais, par ailleurs, cette phrase se veut une mise en abyme de mon propre travail : l’argot que parlent mes personnages est une création littéraire, il n’a rien de réaliste.
Pour en revenir à la Série Noire, ce ne sont pas, à mon avis, tant les textes originaux ni les traductions qui lui donnent sa valeur, mais comment cette collection crée, de façon plus ou moins intentionnelle, une réalité nouvelle, une littérature nouvelle, son propre objet.
« Je vous tire mon chapeau. Le titre de « traducteur » taille petit, dans votre cas. Il faudrait inventer autre chose. Vous êtes le maquilleur d’autos de l’édition ! Et pas le genre à se contenter de changer les plaques. Tout au chalumeau et au pistolet à peinture. Il manque des chapitres entiers ! […] A la casse, les pièces détachées ! »
Encore une fois, le Sachem, avec son outrance de vieux truand lettré, a recours au monde des voyous pour métaphoriser un fait littéraire : ce que des critiques plus académiques ont nommé « les belles infidèles de la Série Noire ».
« Vian, je l’avais déjà croisé chez Gallimard, mais je désapprouvais ses mystifications qui desservaient la cause littéraire et nuisaient à la respectabilité des traducteurs ».
Gringoire met du temps à accepter son véritable statut de traducteur, c’est-à-dire pas de traducteur littéraire amis son statut d’intermédiaire entre différentes réalités culturelles, différents milieux sociaux, différents codes de valeurs et différents langages. Il finit par devenir ce que nous sommes tous dans un monde multiculturel : nous adaptons sans cesse, nous traduisons des réalités culturelles, nous en créons de nouvelles. Avant de prendre conscience de « la bâtardise de toute chose », pour reprendre une expression du Sachem, ses illusions d’esthète lui font proclamer la pureté et l’absolu de l’art. Il aspire d’autant plus à la respectabilité qu’il est lui-même un auteur frustré et, de façon générale, un usurpateur, moins par choix que par inertie. Pour moi, au contraire, la littérature est toujours mystification, jeu de miroir, écran de fumée. Elle mélange, elle adapte, elle emprunte, elle détourne et elle dénature. Gringoire voudrait que la traduction soit une science alors qu’elle n’est généralement qu’un traficotage, dirait le Sachem, des mots qui passent clandestinement la frontière, avec leur contrebande de sens cachés dans le double-fond de leurs valises.
Et pour finir sur « l’esprit Duhamel », vous vous êtes amusés à traduire « à la façon de »…
Après tout ce que je viens de dire, vous vous imaginez bien que je considère le texte comme un carrefour d’influences, intertextuel, dialogique, référentiel, ouvert à tous les vents. Loin des tours d’ivoire, le texte est une rencontre, que Pas de littérature ! met précisément en scène. Ma littérature est hybride, ni noire ni blanche, à la fois divertissement, action, course-poursuite et réflexion, théorie, métadiscours, elle en appelle aussi bien à Villon et Hugo qu’à Hammett et Simonin. Mais si vous faites allusion à Fiction murders, le roman que Gringoire traduit sous le titre de J’en parlerai à mon cheval, c’est une petite forgerie de clichés et de scènes topiques du roman noir, dans une langue qui parodie l’argot des premières traductions de la Série Noire, tout en offrant un premier niveau de mise en abyme de la confusion entre réalité et fiction, écriture et action.
