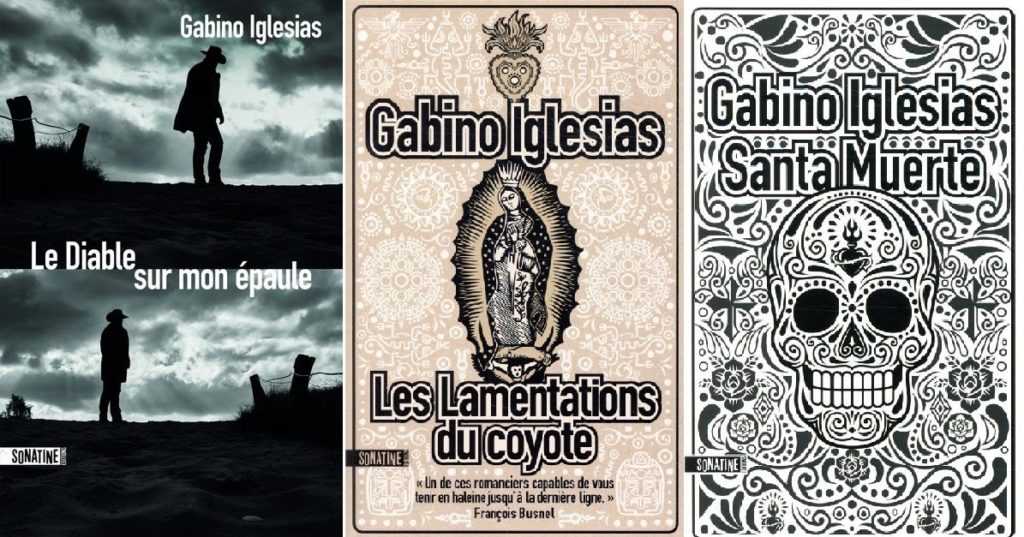À l’occasion de la sortie de Le Diable sur mon épaule chez Sonatine, nous avons rencontré Gabino Iglesias, pour une courte mais passionnante interview, entre Austin, la frontière, la religion et plein d’autres sujets.
Des genres et des langues
Milieu hostile : Votre premier roman Gutmouth, sort en 2012 mais il faut attendre Santa Muerte, sorti en 2020 en France, pour vous découvrir. Quel a été le déclic pour passer au polar ?
Gabino Iglesias : Gutmouth est un livre de science-fiction étrange, mais qui traite aussi de meurtres. Il y avait donc déjà du noir [sourire]. Je pense que chaque auteur passe par un cheminement pour trouver sa voix, pour trouver précisément le genre d’histoire qu’il veut raconter, les raisons pour lesquelles il veut le faire et, surtout, comment il va le faire : le style, la narration, les personnages.
Dans mon cas, après deux livres écrits en anglais – j’ai commencé à n’écrire qu’en anglais en 2008 –, pour Santa Muerte, ce troisième livre, mais le quatrième que j’écrivais, je me battais avec les dialogues en anglais. J’étais fatigué de batailler avec ces dialogues lorsque j’ai eu une révélation : il n’y a aucune raison de chercher à les traduire. Une partie sera en anglais, une autre en espagnol, et c’est tout. Cela semblait authentique et c’était ce dont le roman avait besoin.
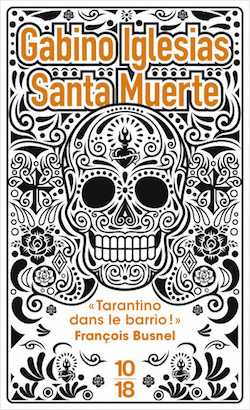
Le roman est sous-titré « Un barrio noir » car, d’après ce qu’on a lu, vous ne vouliez pas vous laisser enfermer dans des frontières littéraires trop restrictives, vous nous dites ?
J’avais toujours entendu : « Si tu fais du roman criminel, ça doit être du roman criminel, si tu fais de de l’horreur, fais des trucs comme Stephen King [sourire], mais il faut que ça reste de l’horreur. » Mais je ne voulais pas de ça, je voulais tout car j’aime tout [sourire]. Noir [en français dans le texte], fiction criminelle, thriller, avec des éléments surnaturels… C’est ce que j’ai fait avec Santa Muerte et je me suis dit, s’ils n’aiment pas, tant pis, c’est OK pour moi car ce n’est pas mon métier, je n’ai ni contrat, ni agent, encore moins d’éditeur, alors allons-y, fonçons et on verra bien. C’était la liberté totale, je faisais ce que j’avais envie, et ça a marché, ça a été édité, traduit en Espagne, chez vous… Là je me suis dit, génial, je peux faire exactement ce dont j’ai envie et il y a des gens qui aiment ce type de romans. Alors j’ai continué.
L’avantage en France c’est que, même si les gens aiment bien mettre les styles dans des cases, on a le terme « noir » qui est suffisamment vague pour tout enrober…
Les Américains sont obsédés par les catégories [sourire]. Comme je disais, si tu fais une fiction criminelle, il faut des criminels et des flics. Si c’est de l’horreur, il faut des vampires, des fantômes, des démons… Et ces deux univers ne se mélangent pas. Les Américains se sont appropriés le terme « noir » et si tu fais du noir, il faut un flingue, un imper, un chapeau, la musique au saxophone [sourire] et ça se passe à New York ou Los Angeles. Et personne n’a le droit de le faire ailleurs [rire]. Je n’aime ni les règles, ni la réglementation, ni les catégories [sourire], alors j’ai écrit un polar qui soit aussi du réalisme magique, avec du vaudou, de la santeria… et en spanglish [rires]…
Quand on ouvre un livre américain, il y a le titre. Et en dessous est indiqué « un roman ». Je dé-tes-te ça. Alors je me suis dit qu’il fallait que je trouve quelque chose. Barrio, c’est le quartier, c’est ça [l’auteur indique le lieu où nous sommes, plein de bars, du monde sur le trottoir, du bruit, de la vie], c’est l’endroit où on vit. J’ai toujours aimé le terme français « noir » car c’est inéluctable, et j’aime. Il fallait donc que j’ai quelque chose à moi, pour englober mes romans. Naturellement m’est venu le terme barrio, et j’ai accolé noir, c’est ça, le barrio noir. Je l’ai mis sous les titres de mes romans (rires)… et ça marche !

Pour Santa Muerte, vous avez travaillé avec J. David Osborne, nous n’avons lu qu’un livre de lui (le seul sorti en France, Que La mort vienne sur moi, traduit par P. Bondil chez Rivages), il y a longtemps, dont nous avons un incroyable souvenir…
J’étais en train de finir Santa Muerte lorsque j’ai eu une invitation pour un événement qui s’appelait « noir at the bar » [rires] où nous allions de ville en ville faire des lectures de nos livres. Je suis allé à Norman, en Oklahoma – sept heures de route pour aller lire un extrait de mon premier chapitre [sourire]. La femme de J. David Osborne est mexicaine, il lit l’espagnol et à la fin de la rencontre, il m’a dit : « J’adore ce mix de langues. Tu sais, je suis éditeur, quand tu l’auras fini, envoie-le-moi, on verra ce qu’il peut bien se passer. » Je l’ai fait, il l’a lu, m’a appelé et m’a dit : « On ne change rien, surtout pas l’espagnol. » Pour l’espagnol, je ne mets pas d’italique, et il m’a dit : « J’aime cette façon de faire, publions-le tel quel. » On a fait deux livres ensemble, car il me laissait faire ce que je voulais [sourire]. Ça a été une belle expérience de travailler avec lui, c’est un excellent éditeur.
La frontière et l’Amérique latine
Vos trois romans ont la particularité de se dérouler à Austin, au Texas, sur la frontière et au Mexique…
Austin est très étrange. C’est une ville intellectuelle, il y a de grandes universités, c’est une ville où la tech est très présente aussi, Apple, Google… il y a de l’argent. Mais c’est aussi très arty, c’est la capitale musicale du monde [sourires]…
Oui, l’Austin Psyché Fest…
Exactement ! Et c’est très étrange, il y a des gens très riches, des musiciens très forts, tous ces universitaires, et ce mix est très intéressant. Ce qui est très marquant, c’est que nous ne sommes pas le long de la frontière, mais nous sommes influencés par la frontière. J’ai passé deux ans à enseigner l’anglais à des travailleurs sans-papiers. Des gens qui travaillaient dans des hôtels, des restaurants, des éboueurs, dans des magasins… Tous ces gens sont des sans-papiers. Nous n’avons pas ce « c’est un problème de frontière » directement, mais indirectement, nous en avons les flux. Personne à Austin n’est d’Austin [sourire]. Tout le monde vient pour aller à la fac ou travailler. Quand vous venez du Sud, vous passez la frontière, vous tombez à Austin. Et durant ces deux années que j’ai passées à enseigner l’anglais, j’ai entendu des centaines d’histoires. J’ai grandi à Porto Rico, du coup je suis un citoyen américain de seconde zone. J’ai un passeport et je peux voyager aux États-Unis, c’est un grand privilège que bon nombre de mes amis n’ont pas. Dans toutes les grandes villes la raison qui fait que tout fonctionne est que la personne qui fait votre vaisselle au restaurant, celle qui vide vos poubelles, celle qui prend soin de votre enfant, est toujours quelqu’un qui vient d’un autre pays. Je voulais vraiment raconter ça. Retracer le parcours de ces gens traversant la frontière. Expliquer ce monde à deux langues. C’est un phénomène de boucle de langage que je voulais explorer.
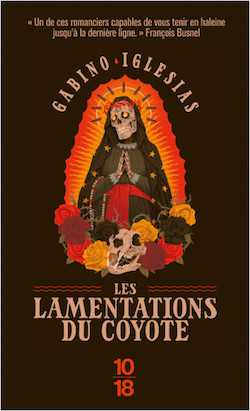
D’ailleurs, vous analysez beaucoup la façon de parler des gens qui immigrent aux États-Unis.
C’est marrant que vous utilisiez le terme « barrière » [une erreur de traduction entre barrière et frontière] car, effectivement cette frontière est une barrière. C’est une barrière, comment la franchir, comment communiquer. La plupart des élèves sans-papiers que j’avais lorsque je donnais des cours n’étaient pas là pour pouvoir parler avec des amis américains, ils étaient là car ils savaient que l’argent et les opportunités ne viendraient que s’ils parlaient anglais. « Tu n’es là que pour laver. Oh, tu parles anglais ? Et bien tu seras leur chef, le nouveau directeur du ménage. » Dans ce cas-là, le directeur de l’hôtel ne parle qu’à toi et toi tu parles aux employés. C’est là que la langue ouvre les portes. Et c’était très important pour eux de parler. Les Américains sont vraiment stupides en terme de mono-langage. Je sais qu’on n’est pas obligés de parler une seconde langue, mais cela ouvre l’esprit. Apprendre un peu de français, d’espagnol… La Floride, le Texas, c’est pratiquement 50/50 entre anglais et espagnol. Alors ne pas parler espagnol, c’est un peu comme venir à Paris et dire « je ne parle qu’anglais »… bonne chance à toi, idiot. Et pendant toutes ces années où je faisais des lectures en spanglish, je terminais toujours en disant « Ce sont les États-Unis d’Amérique, alors apprenez l’espagnol. » Cela rendait les gringos furieux – et ça me rendait heureux. Ce qui les rend furieux me rend heureux [rires].
À lire aussi : Anthony Neil Smith : méchamment féroce
Dans vos trois romans, il y a de nombreux portraits de Mexicains ayant traversé la frontière. Si on ne vous connaissait pas, on vous penserait Mexicain… Vous avancez un peu, dans votre dernier roman avec le personnage de Mario, originaire de Porto Rico, mais pourquoi ce temps pour en arriver-là – et ce n’est pas un reproche [rires].
Le Mexique est présent dans mon livre, mais il y a aussi l’Argentine, Cuba, Porto Rico, la Dominique… tous ces gens qui partent aux États-Unis, cherchant ce mythe américain, qu’ils ne trouvent pas, mais ils sont toujours en vie.
Pour Santa Muerte, cela avait beaucoup plus de sens. Je suis arrivé aux États-Unis en 2008. Au Texas, vous n’êtes ni Colombien, ni Vénézuélien, ni Péruvien ou du Guatemala. Ces pays ont beau exister, si tu parles espagnol et que tu es basané, tu es Mexicain ! Et si par hasard on trouve que tu es du Pérou, on te demande quel style de tacos tu manges là-bas… quelle ignorance. De fait pour Santa Muerte, cela faisait sens de mettre quelqu’un qui venait aux États-Unis, non pas parce qu’il le voulait ou parce qu’il le pouvait, mais parce qu’il fuyait quelque chose. Et lorsque vous fuyez quelque chose, c’est différent. Si vous fuyez Lyon, vous pouvez prendre le train jusqu’à Paris, ça peut faire loin, mais c’est facile. En revanche, si pour le faire, il vous fallait un passeport, ça serait beaucoup plus compliqué si vous n’en aviez pas. Je voulais ajouter cette dimension d’anxiété, de personnage d’outsider : je ne suis pas d’ici, je ne veux pas être ici. Sans oublier tout ce que vous fuyez et les mauvaises rencontres. Dans Les Lamentations du coyote, il y a un personnage portoricain avec Alma. C’est un roman choral, à six voix, que j’ai écrit pendant ces deux ans où je travaillais avec les sans-papiers et je voulais mettre ce type d’histoire, sans raconter leurs propres histoires, car celles-ci sont secrètes et ne m’appartiennent pas. Pour Le Diable sur mon épaule, j’ai mis 30 000 mots pour créer ce personnage, qui m’est très lié. Quand j’ai perdu mon boulot, je me suis retrouvé au chômage, sans couverture sociale, complètement cassé et j’ai mis tout ça dans le roman. Je voulais montrer le privilège que c’est d’avoir le passeport bleu des citoyens des États-Unis. En tant que Portoricain, je suis un citoyen de seconde zone, lorsque je suis arrivé, je suis resté deux ans sans avoir le droit de voter pour les élections américaines, j’ai dû prouver que je comptais bien rester au Texas [rires]. Lorsque j’ai voulu faire changer mon permis portoricain, les deux premières fois au guichet on m’a dit qu’il fallait que je repasse le permis aux États-Unis – avec le temps et l’argent que ça représente – car on me considérait comme venant d’un pays étranger. La troisième fois, je suis tombé sur une fille très sympa qui m’a dit « oh, Porto Rico ? On fait ça tous les jours, donnez-moi ça que je vous le change » et ça a duré dix secondes [rires]. Il leur a fallu trois passage pour accepter un permis portoricain, car, pour eux, nous ne sommes pas un pays étranger, mais encore moins que ça : une colonie. J’étais tellement furieux qu’il fallait que je fasse ce personnage portoricain. Le prochain roman sera à 100% portoricain.
Si le diable est directement en titre de votre troisième roman, les dieux et divinités hantent tous vos livres. On n’avait pas senti un tel poids chez un auteur depuis Nick Stone, avec Haïti et le Vaudou dans sa trilogie Max Mingus… Comment tout ceci prend place si facilement à l’intérieur de vos romans ?
Je ne sais pas si cela représente le même concept en français, mais on peut parler de syncrétisme, d’un mix religieux. Les Caraïbes sont le centre du monde en termes de syncrétisme. Vous vivez dans n’importe quelle rue et vous pouvez être juif, un de votre voisin chrétien, l’autre pratique le vaudou, celui d’en face est catholique, un autre est bouddhiste et il y a des rastafaris de Jamaïque pas loin. Nous n’avons pas le combat qu’ont les Américains au sujet de la religion. Ils mettent Dieu dans leur argent – « In God we trust » – ce qui est ridicule. C’est votre Dieu, c’est OK qu’Il vous bénisse, mais j’ai le mien. C’est pour ça que personne ne se bat à ce sujet aux Caraïbes. C’est tellement mixte que ma grand-mère à Porto Rico ne cessait de dire qu’elle était catholique, mais elle avait ses petits grigris, qu’elle mettait un peu partout. Elle avait un tout petit appartement avec une salle de bains. Mais tu ne pouvais pas t’en servir, ne serait-ce que pour te laver les mains ou aller aux toilettes, car c’était la salle de bains pour les Esprits, elle y avait ses grands cierges votifs. J’ai grandi dans cet univers, alors pour moi tout était normal. Et quand j’ai bougé aux États-Unis, c’était si ennuyeux – « In God we trust » [sourire] – et c’était tout. À Porto Rico nous disons que quand tu tombes malade, toutes les choses aident. Tu peux prier différents dieux en leur demandant de l’aide et peut-être qu’un te répondra et que ça marchera (rires). C’est quand même mieux d’avoir différentes options. Quand j’ai commencé à écrire ces sortes de mix entre polar, surnaturel et horreur, il me manquait ça. Il me fallait des gens qui croient en Santa Muerte ou autres, qui aient leurs bougies, leurs rituels, la santeria, le vaudou… C’était super excitant, et dans tout ce que je lisais par ailleurs, personne ne faisait ça. Alors dans Santa Muerte, les personnages sont très dévolus à Santa Muerte, dans Les Lamentations du coyote vous avez cette superbe couverture. Chaque livre a ses dieux et ses pratiques religieuses spécifiques. Dans ma jeunesse, j’ai lu de nombreux Stephen King et autres auteurs de ce style. Quand vous prenez Lovecraft, qui invente le mythe de Cthulhu, c’est vraiment dingue, cela m’a ouvert la voie pour venir avec mes propres dieux et mixer tout ça. Et c’est vraiment une partie de plaisir à écrire.
Propos recueillis à Lyon en avril 2024 lors du festival Quai du Polar, traduction Juliette Bacheré & Christophe Dupuis
Pour aller plus loin
Santa Muerte, Les Lamentations du coyote et Le Diable sur mon épaule sont tous publiés aux éditions Sonatine et traduits par Pierre Szczeciner.