À l’occasion de la sortie de son nouveau roman La Crête des damnés, chez Agullo, Joe Meno a passé quelques jours en France. L’occasion pour nous de lui poser quelques questions…
Cette interview est la retranscription d’une rencontre animée à la librairie Le Passeur à Bordeaux, lors du festival Lire en Poche. Ce fut une belle rencontre. Joe Meno est passionné, passionnant et on sent que la situation de son pays lui tient à cœur. Il en parle comme quelque chose de très concret, qui le touche, non pas comme de quelque chose d’important, mais très théorique – comme peuvent le faire certains auteurs.
Joe Meno est l’auteur de sept romans et plusieurs recueils de nouvelles. Son premier livre date de 1999. En France nous le découvrons avec Le Blues de La Harpie (How the Hula Girl Sings, 2001), puis Prodiges et miracles (Marvel and a Wonder, 2015), et tout récemment La Crête des damnés (Hairstyles of the Damned, 2004).
Les livres de Joe Meno sont publiés chez Agullo et traduits par Morgane Saysana (Le Blues de La Harpie, Prodiges et miracles) et Estelle Flory (La Crête des damnés)
Rencontre avec Joe Meno
Prodiges et miracles est sorti aux États-Unis en 2015, mais votre prochain roman ne sort qu’en 2020… alors, qu’avez-vous fait entre temps ?
Ha, ha, vous êtes écrivain ?
Non, pourquoi ?
Car c’est toujours la question que se posent entre eux les auteurs : alors, quand sort ton prochain livre ?
Non, désolé, je ne fais que poser les questions…
[rires] J’ai un nouveau livre que je viens juste de finir. Il sortira au printemps prochain. Ce n’est pas de la fiction. Il parle de deux demandeurs d’asile qui viennent d’Afrique et qui vont traverser l’Amérique du Sud pour arriver jusqu’aux États-Unis et essayer d’y faire une demande d’asile.
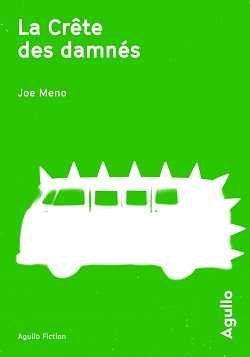
La Crête des damnés
Le livre s’ouvre avec cette phrase, en fin des remerciements : « Vous craignez : Judith Regan, Grave. Et vous tous, tous les vilains gros groupes d’édition. Préparez-vous, la fin est proche ». Alors, le livre date de 2004, en 2019 on en est où de l’édition aux États-Unis ?
En quinze ans, il y a eu un véritable changement dans l’édition en Amérique. À l’époque, il y a eu une grosse concentration éditoriale et les livres publiés devenaient de plus en plus uniformes, standards, et pas très politiques. Depuis, il y a eu une naissance de petits éditeurs, des éditeurs indépendants, et même des presses universitaires, qui ont voulu repousser les limites et publier des auteurs plus intéressants et audacieux. C’est un peu le même phénomène qu’avec le cinéma où, à côté des blockbusters, des petits producteurs et réalisateurs indépendants tentent de faire leur chemin. Pour nous, auteurs, cela devient vraiment intéressant de pouvoir travailler avec ces petits éditeurs.
Lire aussi : 5 raison de : Agullo Éditions
L’ADOLESCENCE
Ce livre est le portrait d’adolescents dans les années 1990. Vous êtes né en 1974, c’est-à-dire que vous aviez 16 ans en 1990. On ne va pas jouer à « ce qui est vrai, ce qui est faux », mais racontez-nous la genèse de ce roman et vos années de lycée à Chicago…
Ce livre est différent de ce que j’ai écrit avant. Il est beaucoup plus autobiographique. Il se passe dans le quartier où j’ai grandi et passé mon adolescence. A la fin des années 80, début des années 90, il y avait vraiment ce sentiment que les choses étaient en train de changer. Mes parents, comme de nombreux autres aux États-Unis, étaient en train de se séparer. À cette époque, c’est un grand changement pour ce qui est de la vision de la représentation de la famille. Au niveau politique, tout changeait aussi. J’ai grandi dans les années 80 avec la guerre froide et là, d’un coup, tout s’effondre, l’Union soviétique éclate et de nouveaux pays apparaissent. Pour nous, adolescents, nous avions l’impression que le monde était devenu instable, ce n’était plus celui que nous connaissions. Autre exemple : j’ai toujours grandi en écoutant la radio. À cette époque, des groupes beaucoup plus politiques apparaissent, ce qui m’a donné une certaine conscience politique. Je ne connais pas l’histoire des grandes villes en France, mais Chicago est la troisième ville des États-Unis. L’histoire de cette ville est celle d’une ségrégation pensée et organisée. C’est à travers la musique que j’écoutais que j’ai pris connaissance de la ville et que j’ai pris conscience de ce qui s’y passait. Le livre retrace tous ces souvenirs-là. Il est une reconstruction fictionnelle de cette époque-là.
Ce livre est le portrait d’adolescents qui veulent s’intégrer.
Effectivement, c’est l’histoire de ce jeune garçon, Brian, qui est dans une période de transition pour trouver sa place dans le monde, dans cette société. Il va devenir de plus en plus politique grâce à la musique qu’il écoute. Au début du livre, il est un peu immature pourrait-on dire, et écoute du rock, du métal, au fur et à mesure de l’histoire, il va aller écouter des choses beaucoup plus politiques, qui parlent de race, de classes sociales. Toute sa transition va passer par l’échange de ces cassettes, ces compilations de musiques. Car à cette époque, les gens prenaient le temps d’enregistrer toutes ces cassettes, avec un ordre particulier des titres à l’intérieur. Et c’était un outil extrêmement puissant qui permettait de raconter une histoire, sur eux, sur le monde. Je peux vous dire que certaines de ces cassettes ont vraiment changé ma vie. Je me souviens – mais je ne sais pas si vous avez eu la même expérience – d’être dans ma chambre, écouter une cassette qu’un ami m’avait faite, pendant qu’à l’étage mes parents se disputaient. En même temps, je regardais mes devoirs, mes mauvaises notes sur mon carnet et tout ça se mélangeait. La musique était la seule chose qui donnait du sens à tout ça, en tout cas qui avait un sens. Et on passait notre temps à rembobiner les cassettes et à se les repasser…
Oui, grande époque, ces cassettes. Le livre m’a également rappelé que c’était aussi l’époque des pin’s…
Ces pin’s étaient extrêmement importants pour nous adolescents. C’est une époque où l’on veut se séparer de sa famille, avoir une identité propre. En même temps, on a besoin d’appartenir à un groupe, d’y trouver sa place. Arborer un pin’s ou le nom d’un groupe sur son sac à dos permettait de trouver une identité et d’appartenir à un groupe. On peut en rigoler aujourd’hui, car ce sont des choses qui se sont passées il y a trente ans, mais en ce moment, aux États-Unis, cette question d’appartenance, cette question de trouver son identité, particulièrement pour quelqu’un qui a 19 ou 20 ans, est devenue extrêmement importante. On voit beaucoup de violence, surtout de la violence raciste, et ce ne sont pas des gamins de 16 ans, mais des jeunes de 19, 20 ans, qui sont déconnectés du monde, qui ne trouvent pas leur place. Quand on y pense, ce sont les mêmes jeunes que j’aurais pu connaître à l’époque lorsque j’habitais ces quartiers-là. C’est impressionnant de se rendre compte à quel point un objet a priori insignifiant comme une cassette de musique était aussi fondamental pour se donner ce sentiment d’appartenance. Quelqu’un vous la donnait vous aviez ce sentiment d’être important, d’appartenir à un groupe.
Chicago est la troisième ville des États-Unis. L’histoire de cette ville est celle d’une ségrégation pensée et organisée.
CHICAGO
Pourriez-vous revenir sur Chicago, sa construction ?
Chicago est une terre d’immigrants. Après les populations natives-américaines, les Français et les Anglais se sont installés, et au début du XXe siècle, les Irlandais, les Italiens, les Allemands… Il y a beaucoup de place à Chicago, c’est une zone géographique plate et très large, donc toutes ces communautés immigrantes n’avaient pas besoin de s’intégrer, de vivre ensemble. Chacun a créé sa zone, avec son église. Les Italiens avaient leurs églises, les Polonais avaient leurs églises… Et pendant 50, 60 ans, c’est ainsi que Chicago s’est développé. Ça a commencé à changer dans les années 1950-1960, lorsque les Afro-américains qui migraient du sud vers le nord du pays se sont installés à Chicago. Les autres communautés ont dû commencer à se mélanger entre elles, car ils ne voulaient pas côtoyer les Afro-américains qui arrivaient. Ils « fuyaient », entre guillemets, devant eux. Et cela continue encore de nos jours.
Chicago est une ville si particulière à ce sujet que les sociologues ont été obligés d’inventer un mot pour décrire ce phénomène si typique de cette ville qui est, je vous le rappelle, la troisième plus grande ville des États-Unis. Ils disent que c’est une ville “hyper-ségréguée”. Donc si vous voulez vivre à Chicago séparé des autres, vous pouvez encore le faire. Le sud de la ville est resté comme ça, très ségrégué, alors qu’au nord les gens vivent ensemble, il y a de la mixité, les idées s’échangent, tout comme la culture, la nourriture… Cela ressemble à de nombreuses autres métropoles. Ce qui n’est pas le cas du sud de la ville. Cette division qui existe encore à Chicago est celle qui divise les États-Unis. C’est la question qui se pose pour le pays. Allons-nous devenir un pays où nous nous mélangeons, où tout le monde a sa place, où tout le monde peut participer ? Ou maintenons-nous cette division ?
[Question du public] Pensez-vous que l’élection de Lori Lightfoot, la nouvelle maire de Chicago puisse changer des choses ?
A priori oui, on est très contents et très excités par son élection. Mais, malheureusement, non. À moins que vous ne trouviez le moyen de forcer les gens à déménager, à changer de quartier, à vivre avec quelqu’un qui ne leur ressemble pas. Mais ils ne sont pas prêts à le faire. Lorsque j’étais jeune, dans le quartier où j’ai grandi, tout était blanc [en français]. La plupart des gens travaillaient soit pour la police de Chicago, soit pour les pompiers de Chicago. Ils voyaient leur quartier comme un refuge. Et ils ne voulaient absolument pas que ça change. Ils ne voulaient pas se mélanger, voir des gens différents s’installer.
Il y a dix ans, nous avons élu le premier président Afro-américain. Il venait de Chicago. Je ne sais pas encore caractériser le sentiment qui nous a envahis. C’était incroyable. C’était fort. Nous étions pleins d’espoir. C’était tellement impossible que ça puisse arriver. Beaucoup d’entre nous avons pensé que ça allait amener beaucoup de changements pour la ville, pour le pays. C’est vrai qu’il y a eu des changements radicaux, nous avons eu quelque chose qui se rapprochait de la sécurité sociale, il a eu l’autorisation du mariage gay au niveau national. Mais en même temps, je n’avais pas reconnu à quel point la peur de l’autre est ancrée chez les gens. La peur du changement. C’est extrêmement fort. C’est pour ça que je dis qu’actuellement, aux États-Unis, si vous voulez toujours vivre séparé des autres, des gens qui ne sont pas comme vous, vous pouvez. Et tant que cela ne changera pas, je ne vois pas comment on pourrait changer les choses. Je suis désolé, tout cela est très sérieux [en français] [rires] mais c’est très important pour nous [en français]. À Chicago, c’est de plus en plus présent. J’ai deux enfants et cela devient difficile de leur expliquer ce qu’il se passe dans la ville. Pourquoi c’est comme ça.
J’ai gardé cette image en tête. Ça me rappelait une image de western, une image de quelqu’un hors du temps.
Prodiges et Miracles
Question bête, mais on ne peut pas en faire abstraction, mais d’où vous est venue cette idée de départ, ce cheval qui « débarque » dans la ferme du grand-père ?
Ce livre est une lettre d’amour au beau-père de ma femme. Quand nous étions mariés, dès que quelque chose était cassé dans la maison, je l’appelais et il arrivait dans la foulée pour le réparer. C’était un ancien vétéran de la guerre du Vietnam. C’était un taiseux, mais dès qu’on se trouvait ensemble pour réparer quelque chose, il commençait à raconter des histoires. Sur son enfance dans l’Indiana, sur la guerre… Il racontait qu’il avait grandi dans une époque de l’Amérique qui n’existait plus. Il avait l’impression que le monde touchait à sa fin. Il n’approuvait pas le mariage homosexuel. Il n’approuvait pas les changements culturels du pays. Mais à chaque fois que j’avais besoin de lui, il était là. Ma relation était compliquée : j’avais beaucoup de gratitude pour lui, mais j’étais souvent en désaccord avec ce qu’il pensait [rires]. La mère de ma femme était cavalière et avec son mari (le beau-père de ma femme, donc), ils allaient souvent s’occuper de chevaux dans des fermes ou des élevages en dehors de Chicago. Parfois ils nous emmenaient. Je me souviens d’une fois où je l’avais vu caresser un cheval avec énormément de tendresse. J’ai gardé cette image en tête. Ça me rappelait une image de western, une image de quelqu’un hors du temps. Il a eu un cancer et en trois mois a été balayé. Cette image, entre lui et le cheval, m’est restée. Elle était si peu caractéristique de lui. Et j’ai commencé à travailler sur le livre. En essayant de comprendre cette image.
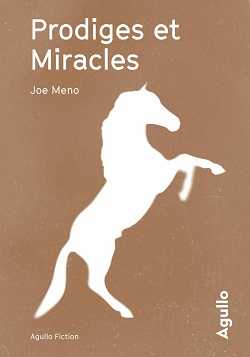
DES HISTOIRES DE FAMILLE
Il y a une belle histoire entre le grand-père et le petit fils.
Oui, c’est l’histoire de ces deux hommes. Cela traite de la difficulté, mais aussi de la nécessité d’exprimer son amour réciproque – ce qui est difficile à faire pour les hommes, je trouve.
Mais votre livre est très noir…
Oui. Les États-Unis vivent une période très sombre en ce moment. C’est noir, ce n’est pas la fin, mais c’est un moment très sombre. J’ai 45 ans et je pense que je n’ai jamais vécu une telle expérience. Du coup, naturellement, mes histoires sont influencées par ce qu’il se passe dans le pays.
Ce qui est très intéressant, justement, c’est la construction du livre, avec ce basculement dans la noirceur, qu’on ne voit pas arriver…
Cette histoire, ce voyage du grand-père et du petit fils à la recherche de leur cheval est comme une odyssée. C’est un hommage aux films noirs, aux westerns, à la mythologie grecque, avec ces personnages qui partent à la recherche de quelque chose et qui vont aller jusqu’au sacrifice pour la récupérer.
Au début du roman, le grand-père a abandonné. Pour lui, c’est la fin des États-Unis, c’est la fin de tout. Le livre se passe dans les années 90, lorsque la meth débarque à la campagne. Sa fille est toxico, il n’a plus d’espoir par rapport elle non plus. Il vit avec ce petit-fils, que sa fille lui a « laissé », mais il ne le comprend pas. Tout ce que le grand-père aime, tout ce qu’il l’intéresse, comme le travail à la ferme par exemple, n’intéresse pas le gamin. Il n’a plus d’espoir, en fait. Et lorsque le cheval débarque, il va tout changer pour un moment. Il va lui donner de nouveau le sentiment qu’il y a un monde des possibles…
Une chance de salut, comme il le dit… « Et si jamais c’était ça, la chose, l’unique chose dont dépendait notre salut ? »
Oui, mais faire face à ce qu’on a fait a souvent un prix élevé. Et, effectivement, c’est une histoire qui tourne autour du sacrifice.

Le Blues de La Harpie
Ce livre est le portrait de Luce et Junior, deux inadaptés face à la société…
A 24 ans, lorsque j’ai eu fini la fac, j’ai eu l’occasion de travailler dans un centre de détention pour adolescents entre 12 et 15 ans. Je faisais des ateliers d’écriture avec eux. C’est une expérience qui m’a énormément marqué. C’était de jeunes hommes qui avaient fait des choses terribles et je voyais comme ces choses avaient laissé de profondes marques en eux. Ils étaient nombreux à être conscients de leurs actes. Mais cela restait des enfants. Et ce qui était marquant, c’est qu’ils ne pouvaient pas imaginer leur futur. Pour eux, il n’y avait que l’institution où ils étaient. Leur futur était parti. Et cette expérience a influencé la construction de mes personnages. Aux États-Unis, et dans la constitution, on a cette croyance qu’on a le droit à une seconde chance. C’est ancré. Mais dans la réalité, c’est quasiment impossible.
UNE SECONDE CHANCE
On le voit dans le livre lorsqu’ils débarquent dans cette ville. Le seul qui accepte d’embaucher des anciens taulards est le propriétaire d’une obscure pompe à essence (on se demande comment il fait), la seule qui accepte de les loger est une vieille folle qui tient une bien étrange pension. On se doute qu’avec ça, ils ne s’en sortiront jamais…
C’est le cas des gens qui sortent de prison, qu’ils aient 18 ans ou qu’ils soient plus âgés. Ils sont tous confrontés à ce genre de situation.
Là ce qui frappe, c’est la maison qui héberge Junior et Luce, comment est-elle arrivée, cette maison ?
[rires] C’est une maison assez étrange qui sort un peu d’un rêve. La femme qui la tient ramasse les animaux morts du quartier et leur fabrique des vêtements pour pouvoir les enterrer avec une cérémonie funéraire. Chacun des personnages dans le livre a un lien avec le passé, en général douloureux, qui les enferme dans leur vie. Ils expriment ça de différentes manières chacun.
Aux États-Unis, et dans la constitution, on a cette croyance qu’on a le droit à une seconde chance. C’est ancré. Mais dans la réalité, c’est quasiment impossible.
Que ce soit dans ce livre ou dans Prodiges et miracles, vous faites le portrait de ces petites bourgades en déshérence…
Ces petites villes-là ne disparaissent pas, mais il y a cette tension aux États-Unis entre les urbains, la banlieue, et ce côté rural, ces petites villes, dont on a l’impression qu’elles ne sont pas trop connectées au reste du pays. Je vis à Chicago et si je fais une heure de route en voiture, je vais rencontrer une de ces villes qui a l’air d’être restée au siècle dernier. Il faut vraiment prendre conscience que Donald Trump n’existe pas sans ces villes. Il a réussi à leur faire croire qu’il allait leur donner quelque chose qui n’existe pas. Qui est en fait la possibilité de retourner dans le passé. Tout le monde aimerait retourner dans le passé pour faire certaines choses différemment. Mais ce n’est juste pas possible. Même en prenant votre voiture ou le train, on sent toujours cette tension avec cette partie du pays qui essaye de vous tirer vers le passé. C’est la première fois que je ressens quelque chose comme cela de ma vie.
Même si je ne suis pas du tout d’accord avec eux, je pense que pour ces personnes, le XXIe siècle est quelque chose qu’ils ne reconnaissent pas, qu’ils ne comprennent pas. Ce qu’ils affrontent est pour eux comme la fin du monde.
Et pour boucler la boucle, Le Blues de La Harpie est dédié à la mémoire de Johnny Cash, dans La Crête des damnés il y a énormément de musique et une playlist à la fin… Quel est votre rapport à la musique ?
Quand je commence à écrire un roman, j’ai juste des scènes. Ce n’est pas encore une histoire, juste des scènes avec des personnages. Et quand je commence à essayer de les assembler, je me demande quelle est la tonalité de ce livre, quelle est sa musicalité. Cela m’aide à trouver le ton et la forme que je vais donner au livre. Pour moi, chaque livre est comme un disque. Et c’est aussi pourquoi chacun de mes livres est différent stylistiquement.
Certains auteurs aux États-Unis cherchent à savoir comment les autres formes artistiques peuvent influencer la littérature. Et je crois que parfois il y a un sentiment que la littérature ne se parle qu’à elle-même. Y amener de la musique est un moyen d’y amener le reste du monde.
La traduction était assurée par Eva Le Pallec.
Pour aller plus loin
Le site de Joe Meno
Joe Meno chez Agullo, sa maison d’édition
Joe Meno au Livre de poche
