Le moins qu’on puisse dire c’est qu’Une guerre sans fin, de Jean-Pierre Perrin, sorti en février 2021 chez Rivages, nous a marqué et nous marquera longtemps encore. Nous aurions 1 000 questions à poser à l’auteur tant le livre est dense, mais la place nous manque, alors allons-y.
Jean-Pierre Perrin, nous vous avions découvert en 1999 avec Chiens et louves. En 2006, sortait Le Paradis des perdantes, et aujourd’hui Une guerre sans fin. Entre temps, vous avez sorti d’autres livres, divers et variés. Comment organisez-vous votre temps d’écriture ?
Je suis totalement désorganisé. Aucune discipline, aucune rigueur, hélas ! J’écris une après-midi par-ci, une soirée par là. Et plus rien, pendant des semaines. En fait, ma priorité a longtemps été le journalisme qui est ma profession et a pris l’essentiel de mon temps. Depuis que j’ai quitté Libération, je suis davantage disponible. Pour les autres livres, ce furent surtout des récits traitant de pays en guerre que j’ai fréquentés sur une longue période : 30 ans par exemple pour l’Afghanistan.
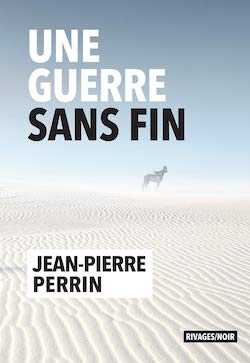
Une guerre sans fin
Pourquoi ce retour au polar aujourd’hui et de quoi est né ce livre ?
Je n’ai plus d’histoire vécue à raconter. Donc, retour à mes premières amours : la fiction. Mon premier livre est d’ailleurs un polar : Chemin des loups (La Table ronde, 1995).
J’ajoute que l’avant dernier polar (Le Paradis des perdantes, chez Stock) est passé à peu près inaperçu. Aucun succès, en dépit de problématiques très contemporaines : il évoquait déjà les relations troubles entre djihadistes et émirats du Golfe à partir de l’histoire (vraie) d’une très grande star du cinéma égyptien victime d’un viol collectif terrible organisé par un prince saoudien pour la punir et elle cherchait à se venger. Cet échec m’a découragé. Comme les récits de guerre marchaient mieux – et qu’ils m’ont valu quelques prix littéraires -, j’ai suivi cette voie.
Parfois, j’ai été (un peu) lâche, parfois courageux. Forcément, cela donne plus de poids aux mots.
Avant d’entrer dans le livre, commençons par les pages 201 et 202 (on ne citera rien, il faut absolument lire le livre), il y a une conversation sur l’écriture, qui on doit être, ce qu’on doit faire, pour écrire. Vous, quelle est votre position ?
La phrase prononcée par Joan-Manuel – « je ne veux pas faire commerce de mon malheur », je l’ai piquée à l’écrivain et ex-otage Jean-Paul Kauffmann. Il me l’avait confiée lors d’une interview. Je la trouve d’une grande actualité. Aujourd’hui, la victime fait volontiers « commerce de son malheur » et occupe la place qu’avait auparavant le héros. La littérature témoigne de ce fait de société, bien sûr. Pour en revenir à Joan-Manuel, il est certes une victime mais il assume son destin. Certes, il échoue à être le héros littéraire qu’il rêve de devenir et c’est sa tragédie. J’avoue être peu intéressé par la littérature qui place la victime au pinacle. J’aime les héros, pas dans le style gros bras, mais ceux qui sont cassés, déchus, tombés, fracassés mais que s’obstine à suivre malgré tout l’ombre de l’honneur.
Cela dit, je suis assez d’accord avec Papa Hemingway qui disait qu’il faut avoir subi le martyre avant d’écrire sérieusement. Du moins dans ce genre de livre. Bien sûr, chacun fait comme il veut. Simplement, sa phrase sonne juste à mon oreille. Sur le chemin de Homs (Syrie, ndlr), j’ai craqué complètement dans un interminable boyau souterrain où il fallait quasiment ramper pendant trois kilomètres, croyant que je n’en sortirais jamais, que j’allais crever étouffé, loin de tout, comme un chien, que je ne reverrais jamais mon fils, âgé alors de six ans, – ce fut une dure leçon. Dans la ville, j’ai fini par pleurer d’accablement devant l’horreur et l’ampleur du désastre. Parfois, j’ai été (un peu) lâche, parfois courageux. Forcément, cela donne plus de poids aux mots.
Le livre traverse de nombreux lieux : Bagdad, Beyrouth, Homs… Lieux que l’on sent que vous avez arpentés et dont vous réussissez à rendre l’ambiance d’une façon parfaite (toute la partie sur le chemin de Homs est admirable) : comment avez-vous réussi ce rendu ?
Je connais ces trois villes, surtout Bagdad et Beyrouth. Pour le chemin de Homs, j’ai repris en grande partie l’itinéraire que j’avais suivi en février 2012 pour y aller, en le simplifiant beaucoup car il s’agit d’un roman. Mais les Syriens du livre existent bel et bien. Mais sont-ils aujourd’hui vivants ?
Trois personnages dans la guerre
Ce livre mêle le parcours de trois personnes : Joan-Manuel, Alexandre et Daniel : comment les avez-vous créés ?
Joan-Manuel est peut-être né de ma propre obsession de me retrouver un jour dans la peau d’un otage. Alexandre et Daniel, je les ai fabriqués de manière à ce qu’ils puissent raconter des histoires qui, elles, sont vraies ou vraisemblables. Mêmes les plus incroyables. Comme celle du footballeur fouetté sur la plante des pieds par Oudaï, le fils cadet de Saddam Hussein, parce que le chirurgien français qui traitait ses blessures provoquées par un attentat l’avait énervé : il avait rapporté de Paris des slips en soie de chez Dior trop grands pour la taille du sexe d’Oudaï et celui-ci y avait vu une atteinte à sa virilité. On pourrait en rire s’il n’y avait un homme qui hurlait de douleur. D’une façon générale, je ne me suis autorisé aucune liberté pour tout ce qui concerne la question de la torture. Le prophète Joseph est vraiment un tortionnaire qui a existé sous ce nom. J’ai rencontré plusieurs de ses victimes qui avaient survécu par miracle. Ses pratiques, aussi cruelles qu’elles furent, ne sont pas exagérées. Il apparaissait déjà dans mon récit sur la guerre en Syrie, La mort est ma servante (Fayard, 2013).
La « partie » de Joan-Manuel est un long travail sur l’enfermement. Il y a aujourd’hui nombre de travaux à ce sujet, mais sur lesquels vous êtes-vous basés plus spécifiquement ?
Aucun. Je n’ai absolument rien lu sur ce sujet. J’ai eu aussi plusieurs copains otages, en Irak et en Syrie. Mais j’ai évité de parler avec eux de leur enfermement de crainte que cela m’interdise ensuite d’utiliser leurs témoignages. En revanche, j’ai noté dans un coin de ma tête les infos qu’ils pouvaient lâcher à l’occasion. Et puis, lorsque l’État islamique a libéré le premier de ses captifs occidentaux – un journaliste espagnol – de Raqqa, je suis allé le voir à Barcelone avec plusieurs parents d’autres otages. Nous voulions savoir dans quel état étaient les autres détenus. Parmi ces otages, j’avais un copain du journal pour lequel je me faisais énormément de souci.
L’otage espagnol a pris soin de mentir aux familles pour les rassurer. Mais, en partant, il m’a pris dans ses bras et m’a murmuré à l’oreille : rappelle-moi. Ce que j’ai fait le lendemain. Là, il m’a décrit une toute autre situation, les tortures, les coups, les noyades simulées, les privations, le prisonnier russe égorgé devant eux, les simulacres d’exécution, l’enfer que vivaient au quotidien les otages, la plupart au bord du suicide. C’est grâce à lui que j’ai appris l’existence des “Beatles”, quatre tortionnaires de nationalité anglaise, et que les garde-chiourmes étaient français. Ce fut un choc. À tel point que j’ai appelé la DGSE. J’ai laissé un message sur un répondeur mais personne ne m’a jamais rappelé. Mais un directeur en retraite de cette agence, contacté par une amie, est venu m’écouter et m’a un peu rassuré.
Nous confessons (mais nous nous rattraperons) ne pas avoir lu Les Rolling  stones sont à Bagdad, mais je suis sûr que nous pourrions y trouver des explications sur les conversations musicales entre Jon et Joan-Manuel… Vous nous en dites plus ?
stones sont à Bagdad, mais je suis sûr que nous pourrions y trouver des explications sur les conversations musicales entre Jon et Joan-Manuel… Vous nous en dites plus ?
C’est un récit qui relate les six derniers mois du régime de Saddam Hussein et l’invasion américaine de 2003. Les bombardements, le fracas de la guerre, les comportements ubuesques du régime baasiste, la violence américaine, nous les avons bien supportés avec un copain du Figaro grâce à une petite cassette des Rolling Stones qui tournait en boucle dans notre Cadillac conduite par un amour de chauffeur. Elle était le contrepoint à la guerre. Et quand nous avons quitté Bagdad, le chauffeur, devenu un ami après six mois passés ensemble, a demandé à la garder. Il l’a ensuite imposée sans fin à tous les journalistes qui nous ont succédé, lesquels ont fini par nous maudire. Pour tout cela, Mick Jagger devrait m’inviter gratis à ses concerts.
Jean-Pierre Perrin, le personnage
Sur le chemin de Homs, nous croisons Perrin, un journaliste… Comment en êtes-vous arrivé là ?
Je voulais entrer coûte que coûte dans Homs assiégée. Alexandre, l’un de mes héros aussi. Nous nous sommes donc rencontrés.
J’ai tenu à apparaître dans le roman pour bien montrer que ce que je décris ne provient pas de l’imagination du romancier et que l’auteur ne se cache pas derrière l’un des trois héros du livre.
On ne va pas passer au crible tout le livre pour savoir ce qui est « vrai » de ce qui est fiction (vous expliquez en note introductive que cette histoire bien qu’inspirée de faits réels est une fiction), mais Perrin est en compagnie de Mary Colvin et Paul Conroy… Tout s’entremêle dans le livre, comment avez-vous procédé ?
Je suis devenu un figurant dans mon livre, comme je l’avais été pendant tout le périple face à la personnalité écrasante de Mary Colvin. C’était une très grande correspondante de guerre, très égoïste aussi, elle voulait être la seule à entrer dans Homs. Donc, j’étais un gêneur. J’ai tenu à apparaître dans le roman pour bien montrer que ce que je décris ne provient pas de l’imagination du romancier et que l’auteur ne se cache pas derrière l’un des trois héros du livre. Il y a également des choses que je tenais à dire personnellement, par exemple évoquer ces Syriennes blessées que l’on préfère laisser crever – c’est le mot le plus juste – parce que les déshabiller pour les soigner en présence d’hommes serait une atteinte insupportable à la religion et à la pudeur. Je me suis aussi décrit un peu ridicule car Mary Colvin et son photographe Paul Conroy me voyaient ainsi. Non sans méchanceté. Je l’ai découvert dans le livre que Conroy a consacré à cette aventure qui se termina de façon terrible parce que Mary fut tuée et lui sérieusement blessé.
À lire aussi : Interview DOA – Pukhtu
Dans le livre, vous convoquez de nombreux écrivains tels García Lorca, Hemingway, Machado, Orwell, et différents protagonistes marchent sur leurs traces que ce soit lîle de Jura ou la Sierra de Guadarrama, comment avez-vous mixé tout ça ?
Ils se sont imposés dans le roman sans me demander mon avis. Ils sont apparus au détour d’une page, aussi simplement que ça. Sûrement parce que je les aime beaucoup. Tous ont un point commun : la guerre d’Espagne qu’ils ont vécue, et certains (Lorca, Unamuno) y ont trouvé la mort. Tous fascinent à leur manière Joan-Manuel au point qu’il se croit habité par un poème de Lorca et qu’il cherche à s’inspirer du credo de Hem prononcé en recevant son prix Nobel : « chacun de ses livres devrait être pour un véritable écrivain un nouveau commencement, un départ une fois de plus vers quelque chose qui est hors d’atteinte. Il devrait toujours essayer de faire quelque chose qui n’a jamais été fait. »
Joan-Manuel, l’otage, mon personnage préféré à cause de sa fragilité, son côté maillon faible, a besoin d’une telle figure afin d’essayer de vaincre ses blessures de l’enfance.
Et vous faites un parallèle entre la guerre d’Espagne et la guerre de Syrie…
La guerre en Syrie traverse le monde arabe mais aussi le nôtre, comme on l’a vu avec les attentats du Bataclan et de Bruxelles, parmi bien d’autres. Elle nous concerne tous, que nous le voulions ou pas. Comme la guerre d’Espagne a concerné toute l’Europe. La guerre en Syrie est le schéma inversé de la guerre d’Espagne puisque les baasistes, un avatar du fascisme, sont au pouvoir et que les démocrates syriens ont été exterminés par le pouvoir syrien et les islamistes, comme l’avaient été les républicains et la gauche démocratique par les communistes. Bernanos a écrit que la tragédie espagnole était la préfiguration de la tragédie universelle.
Pour aller plus loin
Jean-Pierre Perrin et ses livres de fiction chez Rivages, Gallimard, Stock, La Table Ronde,
Jean-Pierre Perrin et ses récits chez Flammarion, La Table Ronde, Fayard, Le Seuil, Nevicata, et son travail chez Libération
